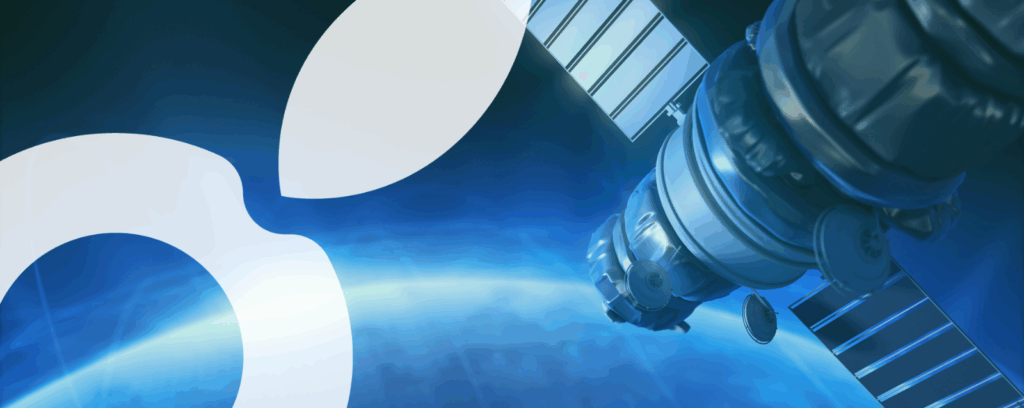Longtemps perçue comme non nécessaire, voire interdite pour la majorité des appellations française, l’irrigation en viticulture devient aujourd’hui un levier stratégique face aux défis du changement climatique, notamment dans certaines régions comme le Sud de la France. Si la vigne est une culture historiquement résiliente à la sécheresse, les conditions climatiques extrêmes, de plus en plus fréquentes tous les ans, mettent à mal la production viticole et poussent les vignobles à repenser leur gestion de l’eau.
Les défis actuels de l’irrigation dans les vignobles
En France, l’irrigation viticole reste fortement encadrée : elle est par exemple interdite pour les vins AOC du 1er mai à la récolte. Mais les sécheresses à répétition, particulièrement dans le sud (PACA, Languedoc-Roussillon), changent la donne. Depuis plusieurs années maintenant, des pertes de rendements sont observées.
Le stress hydrique, s’il est trop important, nuit à la qualité de la plante et à sa pérennité. En effet, ce dernier peut notamment fragiliser les ceps, encore plus chez les jeunes plants dont le système racinaire est peu développé. Pourtant, un « bon stress » reste bénéfique à la vigne, stimulant la concentration en arômes des raisins.
L’enjeu réside donc dans un équilibre subtil. Aujourd’hui, seulement 4 % du vignoble français est irrigué, mais cette pratique est en nette progression, sous l’effet du réchauffement climatique. Nos voisins européens, comme l’Espagne et l’Italie, y ont déjà davantage recours. Dans les pays dits du « nouveau monde viticole » (Argentine, Australie, Brésil, etc.), ce sont 580 000 hectares de surface viticole qui sont irrigués chaque saison (source : Ojeda & Saurin, 2014)
Impact de la gestion de l’eau sur la qualité des vins
L’eau joue un rôle crucial à chaque stade du développement d’une plante et la vigne n’y déroge pas. Un stress hydrique excessif a des impacts significatifs sur le raisin et donc sur la qualité des vins :
- réorientation des ressources vers le système racinaire, et non dans les baies, pour survivre
- limitation de la croissance
- réduction de la taille des baies
- augmentation du pH
- déséquilibre dans les arômes
- etc.
Tout cela entraînant bien entendu une perte de récolte et de rendement. Une bonne gestion de la ressource en eau est donc nécessaire
Les techniques d’irrigation existantes
Plusieurs méthodes existent, elles varient selon les pays, ont des performances et des contraintes variables, mais voici les 3 principales :
Le goutte-à-goutte : la star de l’irrigation viticole
Le goutte-à-goutte, localisé au pied du cep, est aujourd’hui la méthode la plus précise. Elle permet entre autres :
- des apports ciblés et homogènes
- d’éviter l’humidification du feuillage et des raisins
- des économies d’eau allant jusqu’à 20% par rapport à l’aspersion (source Isagri)
Cependant, le système en goutte-à-goutte nécessite une installation et un pilotage précis et rigoureux.
L’aspersion : une solution répandue, mais moins précise
On distingue l’aspersion proche du sol, plus stable face au vent et permettant un arrosage plutôt uniforme, de l’aspersion par canon enrouleur, plus simple à mettre en œuvre, mais moins précise. En effet, cette méthode est davantage sujette à l’évaporation et l’arrosage des feuilles multiplie le risque de développement de maladies comme le mildiou. En effet, l’humidité de l’irrigation associée à des épisodes de chaleurs sont des facteurs plus que propices au développement des maladies fongiques.
Submersion ou arrosage à la raie
Cette méthode, moins utilisée notamment en France, est peu compatible avec des objectifs de qualité. Tout comme l’aspersion, l’évaporation de la ressource en eau y est forte et les irrigations sont moins uniformes.
L’irrigation de précision en viticulture : où en est-on ?
L’irrigation de précision se développe en partie grâce aux outils numériques et à l’intégration dans les exploitations de différentes sondes, capteurs, permettant une connaissance affinée de l’état hydrique de sa culture. Ces méthodes permettent d’ajuster les apports en eau en fonction de différents paramètres, essentiels en viticulture :
- le stade phénologique (débourrement, floraison, véraison, maturation…). Par exemple, une bonne irrigation en période de débourrement ou floraison permet une meilleure croissance des rameaux. En revanche, en période de véraison ou maturité, l’état hydrique de la plante déterminera en grande partie le type de vin produit (dans sa structure, sa teneur en sucre, ses arômes, etc.). (source)
- les objectifs de production : rendement, concentration aromatique, équilibre, etc.
- les contraintes réglementaires propres aux appellations.
Aujourd’hui, plusieurs Outils d’Aide à la Décision (OAD) comme Abelio existent pour accompagner les viticulteurs dans le pilotage de l’irrigation. Certains combinent données météo, observations terrain et imagerie satellite pour affiner les apports parcelle par parcelle.
Quels bénéfices attendre d’une irrigation de précision ?
- Adopter une irrigation de précision en viticulture, c’est investir dans une gestion plus efficiente et durable des ressources avec à la clé :
- une économie d’eau, en phase avec les enjeux environnementaux
- une meilleure maîtrise de ses rendements
- un maintien, voire une amélioration de la qualité de ses vins
- une réduction des risques fongiques selon le système d’irrigation choisi
- et pour finir, un pilotage agronomique affiné, compatible avec les exigences relatives aux différents cahiers des charges des appellations.
L’irrigation en viticulture peut être un véritable exercice d’équilibriste, entre qualité, rendement et respect des réglementations et des cahiers des charges. Encore peu répandue en France, l’irrigation est amenée à se développer, portée par les enjeux climatiques et les innovations agricoles en matière de technologies. L’irrigation de précision, en s’appuyant sur des capteurs, des réseaux connectés et des OAD, permet une utilisation raisonnée et ciblée de la ressource en eau.